Raoul Frary, morceaux choisis
- Jean-Pierre Demouveaux
- 8 mai 2019
- 15 min de lecture
Dernière mise à jour : 5 janv. 2025
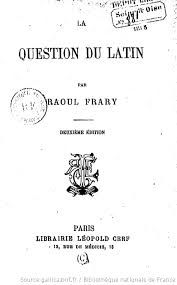
C’est à propos des articles publiés, dans la Stryge, sur 1902 et la réforme de l’enseignement du latin, que j’ai fait la connaissance de Raoul Frary. Cette réforme avait été réclamée par un ouvrage polémique signé de lui quelques années auparavant. “La Question du latin” avait fait quelque bruit dans le Landerneau des milieux cultivés. Rémy de Gourmont, Ferdinand Brunetière l’ont contesté, chacun à leur manière. Mais il est question de bien d’autres choses dans ce livre, où ce qui se rapporte au latin est concentré dans un seul et dense chapitre.
Que savons-nous de Raoul Frary ? Je ne connais aucun portrait ni photographie de lui. Le "Dictionnaire Universel des Contemporains" de Gustave Vapereau (1893) et la notice que Wikipédia lui consacre nous apprennent que, né le 17 avril 1842 à Tracy-le-Mont, mort le 19 avril 1892 au Plessis-Bouchard, fils de médecin, il fit à Paris de brillantes études qui le menèrent au lycée Louis-le-Grand, à l'École normale supérieure (promotion 1860) et au majorat de l'agrégation de lettre (1863). Après quoi il fit une brève carrière dans l’enseignement dans les lycées d’Orléans puis de Mont-de-Marsan (où il fut muté à la suite d’un conflit l’ayant opposé au célèbre évêque d’Orléans, Mgr Dupanloup). Devenu ensuite journaliste en 1869, il collabora au Courrier de France, à L'Écho, au Soir, au National et il assura la rédaction en chef de La France. Ces publications situent Frary dans le courant modéré et libéral de la gauche anticléricale. Des ouvrages qu’il publia, le seul qui fit l’objet d’une réédition est un “Manuel du démagogue”, téléchargeable depuis Amazon pour 3,49 euros (ce que je viens de faire à l’instant : comment résister ?).
Bref, un auteur oublié, comme il en existe tant…
J’ai détaché de "La Question du latin” et du "Manuel du Démagogue" quelques extraits que je trouve savoureux et qui sonnent en résonance avec notre actualité française de 2019. Soit qu’ils auraient pu être écrits de nos jours, soit au contraire qu’ils nous rendent manifestes les changements intervenus. Mais l’intérêt de ces textes ne réside pas, selon moi, dans les idées qui s’y expriment, même si certaines d’entre elles pourraient être reprises par des journalistes d'aujourd'hui. Ils valent, d’abord et surtout, par la qualité de leur écriture. Cette écriture est certes d’une qualité moyenne, mais c’est cette qualité moyenne qui était alors enseignée et recherchée. Le savoir-faire ou le savoir-écrire dont elle témoigne, c’est bien là le résultat que pouvait et voulait atteindre l’enseignement humaniste des lycées, ce fameux enseignement secondaire que Frary lui-même, qui en est le pur produit, s’est tant employé à critiquer.
Car dans les lycées du Second Empire et de la IIIe République, on n’apprenait certes pas à lire et l’on n’encourageait pas, comme aujourd’hui, les élèves à la faire. C’était peine perdue d’ailleurs que de prôner la lecture de Casimir Delavigne... En revanche, on apprenait à écrire. Et à écrire dans cette langue ronde, claire, bien-disante du XIXe siècle, qui partait toute seule comme une toupie dès qu’on la lançait et qui, sur n’importe quel sujet, faisait entendre le même vrombissement tranquille et régulier. Un publiciste des années 1880 pouvait bien prêcher l’apocalypse ou la destruction du monde civilisé, il le faisait abrité derrière une rhétorique qui rassurait et même, parfois, charmait. Aujourd’hui, quand un essayiste se déclarant conservateur prône les vertus de l’enracinement, de la culture traditionnelle et des auteurs classiques, il le fait avec un relâchement de ton et de discours, un approximation dans la syntaxe et le vocabulaire, qui inquiètent autant que le font les discours de ses adversaires (je pense à un cas particulier, celui de Philippe Murray).
En 1885, Raoul Frary se percevait peut-être, dans sa verve et ses éclats rageurs, comme un chien qui aboie. Par le balancement et l’harmonie de son propos, il nous fait maintenant l’impression d’un chat qui ronronne…
***
Des défauts de la presse française
"La presse française gagnerait à ce que l'on l’enseignement officiel fut un peu moins classique. Car elle regorge de polémistes, qui excellent à exécuter un gouvernement en cinquante lignes, à faire en peu de mots la leçon aux peuples et aux hommes d'État ; elle manque de travailleurs qui sachent étudier un sujet à fond, de voyageurs qui suppléent à la sécheresse uniforme des nouvelles fournies par les agences télégraphiques. L'abus des idées générales, élevé par d’éminents pédagogues à la hauteur d'un précepte, est le fléau de notre littérature volante ; on semble croire que pour écrire il suffit de penser, selon le mot de Boileau ; on oublie qu'il faudrait aussi savoir. Comme le public est en somme assez docile, surtout quand on caresse ses défauts, on l'habitue sans peine à goûter les articles qui l'amusent et le flattent de préférence à ceux qui l’instruisent ; la popularité d'un journal n’est le plus souvent qu'un prix de discours français" (R. Frary : La question du latin ; Léopold Cerf, 1885, p. 185).
Du peu d’utilité des mathématiques
"Beaucoup affirment que les mathématiques donnent l'habitude de bien raisonner et font les esprits logiques ; c'est même un aphorisme reçu, quoique plus d'une fois réfuté. Rien n'est plus contestable. La logique des sciences exactes ne ressemble nullement à la logique des sciences humaines. La matière, la méthode, les principes même diffèrent radicalement. Dans les mathématiques, on part d'une définition qui épuise son objet, et on déduit l'une de l'autre des propositions qui s'éloignent indéfiniment du point de départ sans rien perdre de leur rigueur ; si longue que soit la chaîne, le dernier anneau est aussi solide et d’un aussi pur métal que le premier. On peut d'ailleurs s'assurer contre l'erreur, et l'on ne se trompe jamais, quand on raisonne bien. Dans tous ce qui regarde la vie humaine, en morale, en politique, en jurisprudence, en économie sociale, dans les affaires, il n'y a guère de définition qui ne comporte quelque degré d'inexactitude. Aussi ne peut-on se livrer à la déduction sans comparer à chaque pas les idées aux réalités. L'esprit risque d'autant plus de se tromper qu'il place sa confiance dans la précision de sa logique, et c'est une cause certaine d'erreur que de mettre dans la conclusion tout ce qu'on a trouvé dans les prémisses. Un géomètre peut être un moraliste et un homme d'État malgré la géométrie, et non par elle. Que Dieu garde les peuples d'aller chercher leurs conducteurs dans l'école de Platon !" (op. cit., p. 190-191).
Contre les sorties scolaires
"On conseille de faire visiter aux enfants des usines, des ateliers, voire des musées, et même de leur faire traduire leurs impressions dans de petites compositions en français. Pour que de telles excursions ne soient pas simplement ennuyeuses, il faut supposer chez le maître un génie sur lequel on a pas le droit de compter. La pédagogie moderne finit, sous prétexte de progrès, par demander aux maîtres des qualités aussi rare que celles que J.-J. Rousseau suppose chez le précepteur d'Émile. Les collégiens que conduira dans un musée un surveillant ou un professeur médiocrement versé dans la théorie de la ligne et de la couleur, n'apprendront qu'à jaser sur ce qu'ils ignorent, et qu'à répéter comme des perroquets savant des jugements traditionnels dont les motifs échappent d'ailleurs au 19/20èmes des adultes cultivés. On comprend peu de chose à l'organisation d'une usine quand on ne connaît pas à fond certaines parties de la chimie et de la mécanique. Les promenades sont faites pour délasser l'esprit, pour réveiller le corps, et si vous le voulez, pour mettre les enfants en contact avec la nature. Qu’ils courent dans les bois s'il fait beau ; s'il pleut, j'aimerais encore mieux les habituer à recevoir la pluie que de les initier aux mystères de la raffinerie ou de la peinture à l'huile" (op. cit., p. 194-195).
Pourquoi nous nous refusons à toute réforme
"Plus d'une fois les vieilles institutions ont paru à la fois surannées et indestructibles, et l'évidence de leurs défauts n’ôte rien à leur solidité ; les arbres qui deviennent stériles n’ont pas pour cela moins de racines. En pareil cas, les peuples ont deux manières de se tirer d'embarras ; ils se résignent ou ils font une révolution. Quand il s'agit seulement d'un trône ou d'une constitution qu'on a juré de défendre jusqu'à la mort, nous n'hésitons pas à recourir à la révolution ; dans tout le reste, nous nous résignons d'autant plus aisément que la hardiesse de nos propos et la vigueur de nos critiques nous consolent de la timidité de notre conduite ; également soumis et frondeurs, non tour à tour, mais en même temps, nous rions de notre faiblesse, de la médiocrité de nos gouvernants, de la paresse de nos législateurs, de l'éternité des abus, mais notre rire est si brillant et si gai qu'il nous suffit ; nous n’éprouvons pas le besoin de passer à l'action" (op. cit., p. 302-303).
La seule leçon qui soit comprise des gouvernements
"Les abus qui ne sont pas des vexations infligées aux citoyens, mais simplement un gaspillage de force, de temps et d'argent, ne commencent à être ébranlés que quand ils deviennent pour un peuple une cause évidente d'infériorité. Les gouvernements et les nations attendent parfois que la concurrence les éclaire sur leur véritables intérêts ; la seule leçon qui soit sûrement comprise, c'est la leçon de la défaite" (op. cit., p. 304).
La tentation protectionniste
"Les protectionnistes s'efforcent de nous prouver qu'il suffit, pour ramener la fortune de notre côté, de fermer nos frontières aux produits étrangers. Si nous les écoutons jusqu'au bout, nous finirons par nous entourer d'une muraille de la Chine à l'heure même où la Chine renonce à son isolement séculaire, et par former en pleine Europe une île aux rivages inaccessibles. Mais nous ne saurions nous obstiner dans cette gageure contre la science et la raison ; il faudra bien que nous cherchions les causes de nos souffrances là où elles sont, c'est-à-dire dans l'exagération de nos frais généraux, dans l'action excessive de notre gouvernement, et dans notre système d'éducation classique, qui maintient une fausse hiérarchie des fonctions sociales" (op. cit., p. 305).
Contre le collège unique
"Il n'est pas impossible que certains démocrates fassent la guerre aux études classiques comme à une distinction qui sépare trop nettement la classe bourgeoise de la classe populaire. J'accepte leur appui s'il se plaignent de ce que le latin isole ses adeptes du courant général de la société moderne, non s'ils le repoussent comme une cause de supériorité. Car le propre de l'enseignement secondaire est de mettre ses élèves au-dessus de la foule, et il serait bien inutile de conserver des lycées, s'ils n'étaient que des écoles primaires ornées d'un titre pompeux. Je veux une instruction différente de celle qui se donne aujourd'hui, mais je la veux assez forte et assez brillante pour que ceux qui l’auront reçue en portent la marque. S'il ne s'agissait que de laisser tomber le niveau de l'esprit français, j'aimerais mieux défendre une routine qui aurait au moins le mérite d'être une protestation contre le règne de la médiocrité intellectuelle, une barrière un peu vermoulue, mais encore debout, contre l'invasion de la barbarie" (op. cit., p. 306-307).
Alceste homme du monde
"Quoi qu'en pensent les artistes, pour qui l’originalité doit être une vertu, dire d'un Français que c'est un original, c'est lui donner un ridicule. Nous obéissons servilement à la mode, même quand nous la trouvons absurde et gênante. Notre grand poète comique, concevant l'idée d'un misanthrope, en a fait un homme du monde, dont la hardiesse et la sauvagerie ne vont qu’à se révolter contre quelques usages. Juger sincèrement un sonnet, mais avec une sincérité qui s'enveloppe d'abord de périphrases, fuir les embrassades frivoles et les protestations banales, condamner la médisance et ne pas solliciter les juges, voilà toute la misanthropie d'Alceste. S’il s'indigne de la coquetterie de Célimène, ce n'est pas comme misanthrope, mais comme amoureux. Quand il parle de fuir dans un désert, on ne saurait le prendre au sérieux ; on sait qu'il continuera de fréquenter les salons, de s'y faire craindre par ses boutades et d'y être estimé pour sa franchise. Il n'a rien de commun avec le Timon de Shakespeare. ; Il ne veut de mal à personne ; il est fidèle au roi et à l'Eglise, et ses plus âpres sorties contre les moeurs du temps seraient des lieux communs dans la bouche du premier sermonnaire venu" (R. Frary : Manuel du démagogue, ed. Kindle, empl. 161-170).
Aucun courage n'est plus rare que celui qui consiste à plaider une cause perdue
"Nos habitudes de langage trahissent sans cesse l'esprit d'imitation qui nous domine. Nous disons d'un habit : “Cela se porte”, d'une démarche : “Cela se fait”, d'une opinion : “Cela se dit”, et il n'est besoin de rien ajouter. Nous ne tolérons les paradoxes que quand ils sont soutenus avec esprit ; nous ne souffrons la contradiction que si elle nous amuse. Quand nous avons constaté la direction d'un courant, il ne nous reste plus qu'à y céder ; nous ne supportons pas l'idée de rester longtemps à l'écart. Un parti qui a conscience de sa faiblesse numérique est chez nous un parti ruiné. Bien peu de Français pousseraient l'héroïsme jusqu'à persévérer dans une croyance peu répandue, s'ils ne se faisaient illusion sur le chiffre de leur coréligionnaires. Les plus solides arguments ne valent pas le spectacle d'une foule nombreuse, et aucun courage n'est plus rare que celui qui consiste à plaider une cause perdue, simplement parce qu'on la trouve juste, et sans espoir de la faire triompher" (op. cit., empl. 161-170).
Des paresseux et des poltrons...
"Nos modérés semblent n’être que des paresseux et des poltrons. Tout ce qui enflamme l'imagination, tout ce qui flatte la vanité, tout ce qui séduit la multitude, est du côté des partis avancés. Aussi ont-ils réduit leurs adversaires à une défensive timide, mal concertée, mal assurée de ses droits et de la solidité des positions qu'elle occupe. Rien de plus humble que l'attitude de ces conservateurs qui, au lieu de crier à la prétendu avant-garde : “Vous allez à un précipice”, lui disent d'un ton suppliant : “Vous allez trop vite”. Il est aisé de répondre qu'on ne va jamais trop vite au bien, et que l'humanité n'est pas obligés de régler son pas sur les asthmatiques et les boiteux" (op. cit., empl. 417).
Une flèche tirée dans la nuit noire
"Quand le pouvoir prend une décision, il est bien rare que ceux mêmes qui l'ont conseillée en saisissent toute la portée. Les grands hommes même obéissent plus à l'instinct qu’au calcul, et l'instinct trompe même les grands hommes. Richelieu et Louis XIV savaient-ils qu’en ôtant à la noblesse toute ombre d'indépendance, sans lui ôter aucun de ses privilèges, ils préparaient l'avènement de la démocratie ; Charles X savait-il qu’il est ruinait l'influence du clergé ; M. Guizot qu'il compromettait la bourgeoisie ; Napoléon III que la délivrance de l'Italie ferait la grandeur de la Prusse, et que la Prusse agrandie renverserait l'Empire ? Il semble parfois que les sages et les fous soient égaux devant le caprice de la fortune et l'ironie des événements. Une résolution grave est le plus souvent un saut dans les ténèbres, une flèche tirée dans la nuit noire. La plupart des lois sont des semences qu'on jette au hasard, sans savoir si la plante qui en sortira sera cèdre ou hysope, remède ou poison" (op. cit., empl. 483).
Le zèle, c’est une vertu de tous les jours
"Il en est du zèle comme du désintéressement ; Il ne sert qu’en tant qu'on le montre. C'est une vertu de tous les jours, et qui n'éclate jamais si bien que dans les petites choses. Ou plutôt il n'y a rien de petit pour le zèle ; le sentiment ennoblit les détails. Un apôtre zélé ne recule devant aucun labeur, ne dédaigne aucune conversion. Un diplomate zélé ne sacrifie aucun des intérêts qui lui sont confiés, marchande jusqu'aux plus minces concessions ; un domestique zélé n'oublie rien, ne néglige rien. Talleyrand a condamné le zèle, mais il avait ses raisons : il était paresseux, et il craignait de se compromettre. Le peuple veut des serviteurs durs à la fatigue, et des champions qui se compromettent volontiers, toujours prêts à se couper la retraite, à brûler leurs vaisseaux.
L'homme d'État connaît l'importance relative des questions, la hiérarchie des problèmes. Mais il doit l'oublier quand il s'agit de prouver son zèle. Celui qui, pendant la Terreur, proposa de planter des pommes de terre dans le jardin des Tuileries, n'était probablement pas un sot. On fait presque autant de plaisir à un avare en lui faisant épargner un sou qu’en lui faisant gagner mille francs. La destruction d'un abus imperceptible produit parfois autant d'effet que la réforme la plus essentielle (...). Si l'on ne vous a laissé rien de grand à faire, rien de considérable à imaginer, rabattez-vous sur des minuties, dont vous relèverez la valeur en piquant l'amour-propre de ceux à qui vous voulez plaire. Il faut que dans tous les concerts votre instrument donne sa note, et qu'on le remarque ; il ne s'agit pas de jouer juste, mais d'être entendu" (op. cit., empl. 671-679).
La louange n’est jamais trop forte
"La louange n'est jamais trop forte. Il n'est pas bon qu'elle soit grossière ; elle peut sans inconvénient être excessive. On nous dit rarement autant de bien de nous-même que nous en pensons. S'il arrive, par hasard, qu'on dépasse notre propre opinion, nous ne sommes pas fâchés qu'on nous fasse faire des découvertes dans le vaste domaine de notre mérite. Aussi les éloges les moins justifiés sont-ils souvent les mieux accueillis : ils sont plus neufs. Persuader à un poltron qu'il a du courage, un débauché qu'il a de la sagesse, à un sot qu'il a de l'esprit, c'est le comble de l'art. Mais il faut savoir s'y prendre avec délicatesse, et ne point faire de l’encensoir un pavé. On y réussit avec du tact, et en choisissant bien ses preuves. Quel est le poltron qui n'a jamais eu une heure de courage, fût-ce par désespoir, le débauché qui n'a jamais été vertueux, fût-ce par lassitude, le sot qui n'a pas eu de l'esprit une fois en sa vie, fût-ce de l'esprit emprunté ? Si vous avez affaire à une multitude, la tâche est bien plus facile : les individus ont quelquefois de la conscience, et même de la modestie. Mais on ne se tient pas pour responsable du mal fait en commun, et l'amour-propre perd toute pudeur quand il devient collectif. Pourquoi repousserai-je des compliments dont je ne prends que ma part que je peux faire aussi petite qu'il me plaira. Ce qu'on se retranche à soi-même, on le donne au corps dont on fait partie, qu'on aime par devoir et qu'on admire par habitude" (op. cit., empl. 728-737).
Les idées les plus puissantes sont des idées exclusives, étroites, fausses à beaucoup d'égards
"Supposez que nos pères aient eu des notions plus exactes sur les conditions de la liberté et les nécessités du gouvernement, qu'ils aient su tout ce qu'il y avait à emprunter aux Anglais et aux Américains, tout ce que la philosophie du XVIIIe siècle renfermait de vieux, de faux, d'incomplet et de superficiel. Transformez ses prophètes d'une doctrine audacieuse et arrogante en politiques savants et prudents, nourris des enseignements de l'histoire, éclairés par une étude approfondie du cœur humain : croyez-vous qu'ils auraient eu autant de courage, d’élan et de feu ? Leur ignorance et leur étourderie furent une partie de leur génie et de leur force. Saint Paul n'aurais pas remué le monde gréco-romain s'il avait possédé la science des religions comparées, et Polyeucte eût laissé la foule se presser dans le temple de Jupiter si on lui avait appris que tous les cultes ont un fond commun, sont les manifestations diverses d'une même faculté de l'âme humaine. Les idées les plus puissantes sont des idées exclusives, étroites, fausses à beaucoup d'égards" (op. cit., empl. 793-801).
Le parti de la science
"Les savants connaissent les limites de leur domaine actuel, ils craignent d'anticiper sur les conclusions que l'avenir seul tirera légitimement d’un plus vaste amas d'observations (...). Il n'en est pas toujours de même des demi-savants. On les trouve plus tranchants, plus sûrs d’eux-mêmes, plus prompts à revendiquer une autorité contestable, à affirmer ce qu'ils ignorent au nom de ce qu'ils savent. C'est surtout dans leur bouche que sans cesse on rencontre ces locutions impérieuses: “Il est démontré… Il est reconnu... La science moderne prouve…” Mais ce sont les purs ignorants qui embrassent avec le plus d'enthousiasme le parti de la science. Ne pouvant la posséder, ils se font une joie de la servir : leur zèle les console de leur indigence intellectuelle. Incapables de vérifier et de contester ce qu'on leur présente comme certain, ils croient : ils se procurent ainsi tout ensemble les jouissances de la foi et celle de la connaissance" (op. cit., empl. 881-890).
Une assemblée populaire n'hésite pas
"Une Chambre ne se croit jamais trop bien informée ; elle charge des commissions d'étudier les projets qu'on lui présente. Elle consulte les juristes sur la législation, des militaires sur l'organisation de l'armée, les médecins sur l'hygiène, des économistes sur l'assiette des impôts, des ingénieurs sur les travaux publics. Puis elle écoute une longue série de discours : encore lui arrive-t-il d'hésiter après s'être entourée de tant de lumières. Une assemblée populaire n'hésite pas. Elle n'a que faire des spécialistes. Elle supporte parfois la contradiction, pour s'amuser, pour assister à un tournoi dont le vainqueur est désigné d'avance : il serait fade de toujours applaudir ; il faut bien de temps en temps qu'on ait de quoi siffler. Mais l'homme qui ouvre un journal, le citoyen qui prend place à un meeting, ne demande qu'une chose, c'est qu'on lui fournisse de nouveaux motifs de se complaire dans son opinion" (op. cit., empl. 881-890).
Rassemblez un millier de braves gens...
"Les Chambres discutent une question de finance. On allègue l'expérience, le droit, la raison ; on cherche péniblement quelle en est l'incidence, ce qu'il donne aux Trésor, ce qu'il coûte aux contribuables, sur qui en retombe finalement le fardeau. On compulse les statistiques ; on interroge les banquiers, les commerçants, les économistes ; on s’informe de l'opinion des Anglais, de la pratique des Américains : on gémit sous un monceau de chiffres ; on se perd dans un dédale d’arguments. Convoquez une réunion publique ; rassemblez un millier de braves gens, tribuns de cabaret et laborieux ouvriers, citoyens pleins de zèle et badauds qui ne savent que faire de leur dimanche. Soumettez-leur la question qui embarrasse les Académies et qui rend les hommes d'État perplexes. S'il vous faut plus d'une demi-heure pour exposer le point en litige, convaincre votre auditoire de sa compétence, plaider une cause et la gagner, vous ne savez pas votre métier. S'il reste dans la salle dix homme qui, après vous avoir entendu, ne se sentent pas plus éclairés que la Chambre et le Sénat réunis, dix hommes qui doutent de leur propre autorité, de leur aptitude à trancher le départ, qui s’avouent tout bas incapables de voir clair là où tâtonnent les hommes les plus éminents, vous ignorez les éléments de l'art de flatter. Changez de carrière, ou mettez-vous à l'école, et étudiez les maîtres, qui ne manque pas" (op. cit., empl. 914-922).




Commentaires